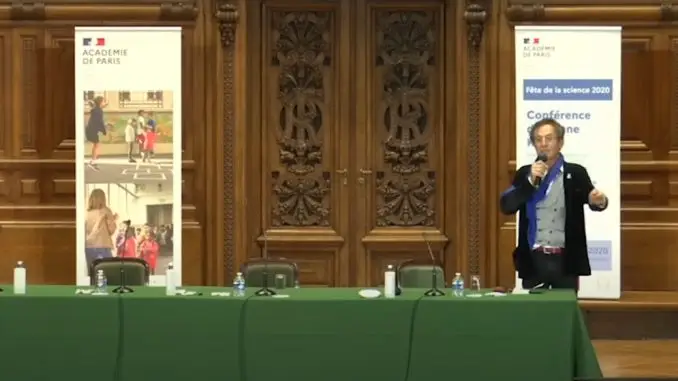
Abdelali JABRI
Introduction
La conférence Le Goût du Vrai, prononcée par Étienne Klein dans le cadre de la Fête de la Science 2020 à la Sorbonne, constitue une réflexion profonde sur la nature de la connaissance scientifique, ses mécanismes de validation et ses rapports complexes avec la vérité. Physicien et philosophe des sciences, Klein y aborde des questions fondamentales : Qu’est-ce qu’une vérité scientifique ? Comment la distinguer d’une simple croyance ? Pourquoi la science contredit-elle souvent notre intuition ?
Cet article propose une analyse approfondie des thèses développées par Klein, en les éclairant par des apports épistémologiques, cognitifs et historiques. Nous explorerons successivement :
-
La distinction entre science et recherche ;
-
La nature des vérités scientifiques ;
-
Les biais cognitifs et les illusions de l’intuition ;
-
Les rapports entre physique et philosophie ;
-
Les défis contemporains du « goût du vrai » dans l’espace public.
1. Science vs. Recherche : Deux Facettes Complémentaires
Klein établit une distinction cruciale entre la science, entendue comme un corpus de connaissances validées, et la recherche, qui constitue un processus dynamique d’investigation.
1.1. La science comme corpus de connaissances
La science repose sur des vérités provisoires mais robustes, éprouvées par des vérifications expérimentales et théoriques. Exemples :
-
La rotondité de la Terre (bien que sa forme exacte soit un géoïde) ;
-
L’existence des atomes (confirmée par la physique quantique) ;
-
L’expansion de l’univers (observée via le décalage vers le rouge des galaxies).
Ces connaissances ne sont pas absolues mais relativement stables : elles peuvent être reformulées (comme la mécanique newtonienne intégrée dans la relativité générale) ou invalidées (comme la théorie du phlogistique ou de l’éther luminifère).
1.2. La recherche comme processus de doute
La recherche, en revanche, est le domaine de l’incertitude. Elle consiste à explorer des questions sans réponses définitives :
-
Quelle est la nature de la matière noire ?
-
Comment concilier relativité générale et mécanique quantique ?
Klein critique la confusion entre ces deux aspects, notamment dans les médias, où des chercheurs exprimant leur doute sur des questions ouvertes (comme l’évolution d’une épidémie) sont parfois remplacés par des pseudo-experts plus affirmatifs mais moins rigoureux.
Implications épistémologiques :
-
La science progresse par réfutation (Popper, La Logique de la découverte scientifique, 1934).
-
Le doute méthodique (Descartes) est nécessaire en recherche, mais ne doit pas être étendu aux connaissances déjà validées (ex. : climatoscepticisme).
2. La Vérité Scientifique : Entre Universalité et Révisabilité
2.1. Des vérités non absolues mais universelles
Klein souligne que les vérités scientifiques ne sont pas des dogmes, mais des constructions rationnelles universellement vérifiables :
-
Un physicien chinois et un français aboutissent aux mêmes équations pour décrire la gravitation.
-
L’ADN a la même structure, qu’on l’étudie à Paris ou à Tokyo.
Cependant, ces vérités sont contextuelles :
-
La mécanique newtonienne reste valide à faible vitesse, mais est dépassée à l’échelle cosmologique.
-
La notion de « Terre tournant autour du Soleil » doit être nuancée en relativité générale (où tous les référentiels sont équivalents).
2.2. L’évolution des paradigmes scientifiques
Klein rejoint Thomas Kuhn (La Structure des révolutions scientifiques, 1962) en montrant que la science avance par changements de paradigmes :
-
La théorie du phlogistique (18ᵉ siècle) a cédé la place à la thermodynamique.
-
L’éther luminifère a été abandonné après l’expérience de Michelson-Morley (1887).
Critique du relativisme postmoderne :
Certains penseurs (comme Bruno Latour) considèrent la science comme une construction sociale. Klein s’y oppose, arguant que son efficacité prédictive (ex. : découverte du boson de Higgs en 2012) prouve qu’elle décrit une réalité objective.
3. Biais Cognitifs et Illusions de l’Intuition
Klein illustre comment la science nous détrompe en révélant les limites de notre perception et de notre raisonnement spontané.
3.1. Exemples de dissonances entre intuition et science
| Intuition | Réalité scientifique | Explication |
|---|---|---|
| Un ruban de 1 m ajouté autour de la Terre nécessiterait une surélévation infinitésimale. | La surélévation est de 16 cm, quelle que soit la taille de l’objet (Terre, balle, atome). | Formule mathématique : h=L2π (où L = longueur ajoutée). |
| Les corps lourds tombent plus vite. | La trajectoire dans un champ gravitationnel est indépendante de la masse (Galilée, Einstein). | Principe d’équivalence en relativité générale. |
| Le marbre semble plus froid que le bois. | Les deux matériaux sont à la même température. | Conductivité thermique différente (le marbre absorbe la chaleur de la main plus vite). |
3.2. Biais cognitifs fréquents
-
Biais du survivant : Analyser uniquement les données disponibles (ex. : renforcer les zones touchées des avions revenus, sans considérer ceux abattus).
-
Erreurs probabilistes : Un test médical fiable à 95% dans une population où la maladie est rare (1/1000) donne un risque réel d’être malade si positif d’environ 2% (loi de Bayes).
-
Corrélation vs. causalité : Post hoc ergo propter hoc (ex. : guérison après prise d’un placebo).
Apports des sciences cognitives :
Kahneman (Thinking, Fast and Slow, 2011) montre que notre cerveau utilise deux systèmes :
-
Système 1 (intuitif, rapide) → Souvent trompeur en science.
-
Système 2 (analytique, lent) → Nécessaire pour un raisonnement rigoureux.
4. Physique et Philosophie : Un Dialogue Nécessaire
Klein plaide pour un échange renforcé entre ces deux disciplines, notamment sur des questions comme le temps, l’origine de l’univers ou la nature du réel.
4.1. Le temps : Un concept partagé
-
Physique : Le temps est une variable (t) dans les équations, relatif (Einstein), et peut-être émergent (théorie quantique).
-
Philosophie : Saint Augustin (Confessions) souligne son caractère insaisissable ; Heidegger (Être et Temps) l’associe à l’existence.
Problème de l’ancestralité (Meillassoux) :
Si le temps dépend de la conscience (relationnisme), comment expliquer les 13,7 milliards d’années avant l’apparition de l’homme ?
4.2. L’origine de l’univers et le néant
Klein souligne le paradoxe du néant :
-
Penser le « rien » le fait exister comme concept, ce qui le nie.
-
La physique quantique suggère que le vide n’est pas « rien » (fluctuations quantiques, énergie du vide).
5. Défis Contemporains : Ultracrépidarianisme et Ipse Dixitisme
Klein identifie deux menaces majeures pour la rationalité :
-
L’ultracrépidarianisme : Parler hors de son domaine de compétence (ex. : influenceurs commentant la physique quantique).
-
L’ipse dixitisme : Croire une affirmation parce qu’elle émane d’une autorité (« Untel l’a dit »).
Enjeux sociétaux :
-
La méconnaissance des méthodes scientifiques favorise la propagation des fake news.
-
La distinction entre savoir et opinion s’estompe (ex. : sondages sur l’efficacité de médicaments non encore testés).
Conclusion : Cultiver le « Goût du Vrai »
La science, selon Klein, est une aventure intellectuelle exigeante mais gratifiante, qui nous libère de nos illusions tout en ouvrant de nouveaux mystères. Elle nécessite :
-
Humilité : Accepter que nos intuitions soient souvent erronées.
-
Rigueur : Distinguer savoir établi et recherche en cours.
-
Curiosité : Poser des questions audacieuses, comme Einstein enfant (« Que verrais-je si je chevauchais un rayon de lumière ? »).
Dans un monde saturé d’informations non vérifiées, le « goût du vrai » apparaît plus que jamais comme un rempart contre l’obscurantisme et une boussole pour naviguer dans la complexité du réel.
Références complémentaires
-
Bachelard, G. (1938). La Formation de l’esprit scientifique.
-
Popper, K. (1934). La Logique de la découverte scientifique.
-
Kuhn, T. (1962). La Structure des révolutions scientifiques.
-
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow.
-
Meillassoux, Q. (2006). Après la finitude.
Cet article approfondit et contextualise les idées de Klein, tout en les confrontant à d’autres approches philosophiques et scientifiques, offrant ainsi une vision synthétique et critique du « goût du vrai »

Soyez le premier à commenter